Marceline et Joris
Il y a ces jours-ci sur les ondes (france culture, le soir à 8 heures, « à voix nue ») la transmission d’entretiens effectués avec Marceline Loridan-Ivens. En une sorte d’hommage que je rends à cette femme formidable, je reproduis ici un travail effectué il y a près de dix ans, lors d’une manifestation présentant presque tous les films de Joris Ivens, et certains auxquels Marceline Loridan-Ivens participa. Femme de coeur, digne, courageuse, forte, je me souviens d’elle qui se penche sur la table, dans « Chronique d’un été » (Jean Rouch, Edgar Morin, 1961), riant ou posant la question « Est-ce que vous êtes heureux ? » à quiconque passe… J’illustre ce travail de quelques photographies prises ici et là, entre autres sur les chantiers de l’arrondissement 10, à Paris ces temps-ci.
Rétrospective Joris Ivens
Cinéma Jean Bertin, Cité des Sciences et de l’Industrie
Du 8 au 22 juin 2003.
La chaise n’est pas restée vide
L’occasion de croiser des spectateurs de la rétrospective « Joris Ivens » organisée au cinéma Jean Bertin de la Cité des Sciences et de l’Industrie était trop belle pour ne pas être saisie. Du moins, était-ce mon avis. Contrairement à l’habitude, mon habitude professionnelle, celle qui fait que je me trouve à tel endroit, à telle heure, pour observer et interroger les « publics », personne ne m’avait rien demandé à propos de ces projections : j’étais là, disons, par hasard. Mais je travaillais aussi, à autre chose.
J’ai rencontré une douzaine de personnes, trois week end d’affilée. Elles étaient venues regarder des films qui, dans une certaine mesure, tentaient de retracer, comme l’annonçait le petit document disponible à l’entrée, le parcours d’« un cinéaste dans la tourmente du vingtième siècle ». Cinéaste, certes. Tourmente aussi. Encore que… On pourrait discuter à l’infini de ces tourments engendrés par les siècles, celui dans lequel nous vivons comme tous les autres.
Lorsqu’on étudie le cinéma, on croise Joris Ivens : j’en ai fait l’expérience ; on en croise d’autres sans doute aussi, alors pourquoi lui ? A cette question, je n’ai pas trouvé de réponse sinon « pourquoi pas ?» qui n’est pas très satisfaisante. A la réflexion, j’ai pu, avec celles et ceux qui s’y prêtèrent, convoquer les sciences, puisque ces spectacles se tenaient dans un des palais qui leurs sont consacrées. Un grand nombre de personnes s’était donné rendez-vous là sans le savoir vraiment.
Des plus proches de l’univers du documentaire aux plus éloignés de ces considérations : la question du « genre cinématographique » est de celles qui m’intéressent, mais elle n’a pas de sens sinon celui évident (mais pour qui, cette évidence ?) du classement : il (me) fallait donc la poser.
Des plus proches de l’univers d’Ivens aux plus éloignés : le cinéaste est mort en 1989, l’année de la chute du mur de Berlin. Oui, bon. L’opuscule tentait le parallèle entre Jean Painlevé et Joris Ivens : pourquoi pas ? De la vingtaine de films projetés, je n’en avais vu aucun. De ceux de Painlevé, il en est presque de même.
Pour moi, le documentaire, c’était « Nanook l’esquimau », Raymond Depardon et la campagne présidentielle de VGE, les commissariats de police, les drogués, des thèmes chers aux sociologues malgré tout, ou aux ethnologues, comme Jean Rouch qui expliquait à ses étudiants le pourquoi du comment de « Chroniques d’un été » (où apparaissait, d’ailleurs et comme par hasard, Marceline Loridan) ou de « Moi un noir », des cadres institutionnels, des conditions de production légères et plus ou moins personnelles, des prénotions ou des présupposés dirait mon maître, mais je n’allais pas me formaliser. Le travail (ou « le métier ») entrepris, bien que non missionné, serait effectué dans la liberté. Pas de guide d’entretien ? Pas de guide d’entretien. Des idées préconçues, et des hypothèses à vérifier. L’une d’entre elles est celle qu’on intitule avec une sorte de jouissance technocratique « la gratuité ». Oui, car ces séances étaient gratuites : ce qui veut dire qu’aucun argent n’était demandé à l’entrée de la salle pour pouvoir s’y asseoir. Et elles parvinrent, sans doute en conséquence, à attirer plus de sept cents personnes. Pour douze séances, j’ai abouti à une moyenne de 60,5 spectateurs par séance, ce qui pour une « jauge » de 90 places, est assez conséquent (bien que le virgule cinq soit toujours aussi importun : cependant, j’aime les chiffres…).
Suffisamment conséquent en tout cas : le premier des samedis où je n’avais pas encore résolu de me pencher sur ce « public », la salle était emplie comme un œuf. La deuxième séance de ce samedi-là, elle était pleine aux deux tiers. La bizarrerie devant tant de monde fut ma première impression : pas l’habitude de voir ça dans cet endroit-là, même lorsqu’il y avait eu là Romain Goupil, ou d’autres personnes disons connues. Mais je ne veux pas comparer à ces conférences données, fût-ce par Hubert Reeves ou Pierre-Gilles de Gennes, puisque eux étaient là, en chair et en os. La veille de ce premier samedi, le vendredi donc, Marceline Loridan-Ivens était accueillie dans l’auditorium, pour lancer cette rétrospective, mais je n’avais pu me rendre à ce coup d’envoi. Et la veille, d’ailleurs, je n’avais aucunement l’intention de m’entretenir avec les « publics » de cette rétrospective. Ce sont eux, les « publics » qui m’appelèrent (et comme d’habitude, parce que là, il s’agit d’une habitude, je n’ai pas dit non).
Ce samedi-là donc, j’ai vu « La Pluie » et « La Seine a rencontré Paris », deux merveilles, et il se peut que ce soit aussi de cette vision que mon désir de savoir se soit manifesté.
J’étais debout, je regardais tous ces visages tournés vers l’écran puis l’écran, je voyais une femme qui prenait des notes avec un stylo éclairant, et j’ai pensé à Dziga Vertov, à sa « caméra stylo » et par-dessus le marché à Edgar Morin et son « cinéma vérité ».
Je voyais toutes sortes de personnages, assis là, sans bien savoir qui j’allais rencontrer encore, sans savoir non plus que j’allais rencontrer quelques uns d’entre eux, je regardais tout en entendant Serge Regginani qui disait ce texte de Prévert, tout en regardant ces avocats sortis d’une quatre chevaux qui se hâtaient vers le palais de justice à deux pas des quais, sur celui des Orfèvres, ces bateaux mouches et ces clochards, ces enfants, ces femmes et cette eau qui coule, comme celle de la pluie, et je pensais aussi à mon travail qui n’avançait guère, de ce fait. J’avais à faire, cependant. Je me suis éloigné de cette salle. Les odeurs de la Seine, les ponts, les livres sur ce fleuve comme celui d’Isabelle Backouche, « La Trace du Fleuve », les idées de Simenon, la nouvelle municipalité, « Paris Plage », « Nuit Blanche », tout se mettait à l’unisson de ces quelques minutes de cinéma.
Le lendemain était un dimanche, et j’étais missionné pour mon travail, toujours. Vers quatorze heures trente, je suis allé voir si je parviendrais à réécouter cette petite musique entendue la veille. Et en effet, elle était là. J’ai reconnu une dizaine de personnes. J’ai vu une vieille dame qui attendait, j’ai parlé avec elle, et c’est ainsi que « les choses vont comme elles vont, de temps en temps la terre tremble » disait le poète, et en plus en chanson, mais je m’égare. Cette vieille dame avait des cheveux blancs, elle attendait que la porte s’ouvrît pour pouvoir s’asseoir, une marcheuse cependant, d’Aubervilliers, et évidemment la musique, Daeninckx et d’autres, Bartabas ou Ralite par exemple, est arrivée avec elle : les bords du canal, les longues randonnées en vélo avec son mari, en Allemagne, au Danemark, et dans toute la France, et aussi « c’est agréable à regarder et ça donne à penser » qui sont les mots de ces gens-là à propos de ces films-là. Elle fut la seule, ce jour-là, mais le plaisir était évidemment là, lui aussi, et l’envie de savoir.
Ce que je cherchais à savoir se résumait à la question : « Ivens aujourd’hui, quelle importance ? », et pour les réponses à ce genre de questions, il faut aborder les choses de biais. Personne ne peut dire, d’emblée, ce qui motive une venue. Le rapport qu’entretiennent les spectateurs avec la séance ou le film qu’ils vont y voir, d’une part, la vie quotidienne de l’autre, ne s’explicite pas simplement parce que quelqu’un vient vous voir et vous pose des questions, dont celle-là. Que nous apporte-t-il donc, aujourd’hui, ce réalisateur ? Mais ces questions-là ne sont que des hypothèses, je les avais en tête dans les entretiens que j’ai menés mais je ne les poserai pas, parce que dévoiler le « pourquoi » ne mène jamais à grand-chose : c’est le « comment » qui importe plus, alors, parce que ceux qui parlent savent plus facilement répondre à des injonctions qui viennent de la réalité. La question des représentation vient seulement avec l’analyse.
Alors, évidemment, plus tard, lorsque j’ai rencontré les personnes en charge de ces séances, j’ai su que cette rétrospective faisait partie d’autre chose, et que la place que Joris Ivens y occupait devait beaucoup au hasard. On sait bien, cependant, que le hasard n’expliquera jamais rien et qu’il n’existe pas vraiment, sauf dans l’idéal, ou l’imagination, de ceux qui l’invoquent. Les films scientifiques, mais pas seulement les documentaires, les « questions de société » comme on dit aujourd’hui, l’espace de la réflexion, l’offre gratuite de ces films, difficilement trouvés et achetés, des mesures à prendre pour parvenir à réunir cette vingtaine de films, des relations avec les institutions en charge de certaines copies et avec les « ayants droit », enfin toute la machinerie que nécessite une telle présentation, cela a été élucidé, mais ne m’apportait guère de suite dans les idées que je me faisais de ces films et de ce réalisateur.
« Symphonie industrielle » est une sorte de titre, ou de sous-titre, de l’un de ces films qu’on vit alors. Au fronton de ce qui est aujourd’hui la bourse du Travail près de la République figurent ces deux mots « art » et « industrie » et ce rapprochement que je tentais lorsque j’ai intitulé « Le Pont des Arts » une étude que je commis sur l’exposition « Les Ingénieurs de la Renaissance » me revint en mémoire. La musique, l’art et l’industrie ont quelque chose à voir ensemble, et d’ailleurs, les rythmes des images de ces films suggèrent quelque chose comme cette musique, ce « tempo » propre aux usines, aux villes et à ceux qui les habitent et les animent.
J’ai vu « Le Pont » et quelques images de « L’Electrification et la Terre ».
Vers six heures, je les ai vus sortir : des spectateurs de cinéma qui s’en vont après une séance, le film choisi enfin vu, ça a quelque chose peut-être pas de bizarre (comme ce qui m’avait pris, en regardant la salle comble pour « La Pluie » et « La Seine ») mais de différent au moins : ça ne se presse pas, sauf ce type avec sa moustache qui lui cachait la bouche et ses chaussures de prof je crois bien, maintenant que son image me revient, premier à sortir, vite. Les autres marchent lentement, s’ils sont seuls, ils le restent, s’ils sont plusieurs, ils se parlent : un petit groupe d’hommes, l’un âgé de cinquante cinq ans peut-être, cheveux gris, dans la poche de veste un livre de Deleuze, je lui ai parlé, je ne sais plus s’il s’agissait de ce dimanche ou du suivant, il était là, avec plusieurs jeunes gens qui parlaient : des cinéphiles, ça se reconnaît tout de suite, en réalité, avec un peu d’habitude, non pas seulement parce que ce n’est pas bronzé, ou que ça a les yeux fort enfoncés dans des orbites cernés, pas seulement pour ça, ça parle avec véhémence, ça défend des idées ou des attitudes, des façons de monter une image puis l’autre, des a priori esthétiques ou formels, je les connais assez bien, ils étaient là aussi.
Durant la semaine qui a suivi ce week end, j’ai tenté la démarche consistant à essayer de faire rétribuer cette présence, et je n’y suis pas parvenu, sans doute parce que je ne me suis pas adressé aux bonnes personnes, que je ne connaissais pas d’ailleurs : j’aurai pu parvenir à les connaître. Peut-être pour ne pas avoir à rendre des comptes, ce que je fais cependant ici. Peut-être pour garder une espèce de liberté sur les sujets à aborder avec ces spectateurs. Je n’en avais tout simplement pas le désir. Une démarche tout ce qu’il y a de spéciale, sinon de complètement à côté de la plaque. A peine entamée, je l’ai abandonnée, mais je l’ai tout de même tentée. A moins que ce ne soit celle que j’étais en train de mener, ce deuxième samedi, qui ait été gauchie : auprès de ces personnes, en les regardant entrer dans cette salle où les sièges grincent, où on entend les bruits des chasses d’eau toutes proches, une salle de cinéma, sans doute, mais qui n’en a ni le confort ni la capacité. Une petite salle, le Champo ou quelque chose d’approchant. Un ciné club, sans la présentation ni la discussion qui suit le film, mais peut-être un ciné club quand même.
Les mêmes spectateurs, les fondus de la cinémathèque, des femmes, nombreuses, des personnes âgées, et puis des jeunes gens. Ils étaient un peu moins nombreux qu’aux séances précédentes, mais ils étaient là tout de même. Il y eut « Créosote » avec des plans des bestioles qui ravagent les bois, « Borinage » en caméra cachée pour certains plans, « L’Italie n’est pas un pays pauvre » avec cette fable à laquelle je n’ai pas cru, qui mélange le méthane et les olives. Je n’étais pas tellement là pour regarder ces films, au fond, mais plus pour me rendre compte de ce que ces gens étaient venus chercher. Un professeur de français avait trouvé « excellent, excellent » les différents films qu’il avait vus, surtout « La Pluie » et « l’Electrification et la Terre » : peu à peu, une image d’Ivens se dessinait. Ce professeur l’appelait « Joris » comme s’il l’avait connu sur les bancs de la communale ; il le parait d’un style, « le style de Joris », il me parlait de marxisme, d’engagement, « c’est une histoire des hommes, mais sûrement pas du côté de ceux qui signent des contrats » . Une documentaliste belge assise devant le cinéma se reposait, fatiguée : elle connaissait ce réalisateur de nom, n’était-il pas belge ? et elle viendrait à la séance suivante. En effet, lorsqu’elle sortit, elle me dit s’être endormie, mais cependant elle avait saisi le caractère de ces films, l’« engagement » de ce réalisateur. Il y a quelques années, une de mes connaissances avait travaillé avec Ivens, et il y avait eu là, pour ce réalisateur, comme une sorte d’aura, ou d’auréole sans doute due au grand art, sans doute parce qu’il était une figure encore vivante de ces pionniers du cinéma, les premiers aussi bien à avoir voulu rendre compte, à tenter d’enregistrer ces luttes. « Son pays l’a rayé de la carte, hein, quand même… ! » me dira avec véhémence la spectatrice au stylo éclairant. Oui, parce qu’il avait choisi son camp, sans doute.
J’ai repensé à ces films documentaires, des documents d’abord, aux frères Lumière (le cinéma juste à côté) et à la sortie de leurs usines, à Albert Kahn et son jardin, à Marcel Ophüls, le fils de Max et de sa Lola Montès avec ses mouvements de caméra, j’ai encore regardé les images d’Ivens, quelques plans de « 17° Parallèle » et « Terre d’Espagne » en entier, sans doute à cause des rapprochements que je peux faire, moi, dans mon esprit, avec les anarchistes, les Républicains, le livre de Javier Cercas, « Les Soldats de Salamine » que j’avais recommandé aux lecteurs du journal interne du parc de la Villette, mais aussi sans doute parce que 1492 et Isabelle la Catholique et l’arbre généalogique de ma famille établi par ma sœur, les vues de Madrid bombardée, et cette fin qui ne dit pas que ces soldats, ces jeunes gens alors qu’Ivens avait alors près de quarante ans, ces hommes pourtant allaient mourir, ou s’établir ailleurs, dans ces camps nommés « centres de réception » par cette administration où l’Ena n’existait pas encore mais son vocabulaire, lui, oui, et leurs ennemis soutenus par ce Benito et cet Adolphe, l’Italie et l’Allemagne, l’axe, Pearl Harbour et Birkenau, Samuel Fuller et son Big Red One, mon père qui disait en parlant de sa croix de guerre, de l’armée et du type sous les ordres duquel il débarqua à Croix Valmer, un peu grinçant, « De Lattre De Tassigny De corvée De chiottes Demain », cette musique et ces chansons, « Bella Ciao’ » ou « Bandiera Rossa » et d’autres, Rosselini et Ingrid Bergman, toute cette panoplie et ce panthéon plus ou moins personnels, ces réminiscences et ces rappels à l’ordre, le siècle et ses documents. Ce dimanche-là, j’ai rencontré un vieil homme en short, un peu débraillé, je ne l’avais jamais vu et je me suis dit qu’il faudrait peut-être aller voir ce qui se tramait dans ces vêtements d’été, ces vieilles baskettes que les jeunes portent plutôt, mais l’homme assis sur le banc n’a rien voulu dire, sinon qu’Hemingway avait attiré son attention. Lorsque des entretiens se déroulent comme celui-là, je n’ai plus tellement envie de regarder ce qui se passe, ni de demander à qui veut répondre ce qui fait qu’il ou elle se trouve ici. Mais j’y retourne quand même.
J’ai été demander à une jeune femme, plus avenante disons, qui me raconta qu’une de ses amies lui avait indiqué cette rétrospective parce qu’elle s’intéressait « aux films ethnographiques ». Je ne suis pas tellement sûr qu’il se soit agi de films de cet ordre, mais Robert Flaherty et Nanook me sont revenus à cette occasion, ce n’est pas que les arrangements que prennent les documentaristes avec la « vérité » ou la « réalité » m’importent tellement d’ailleurs, mais je me suis souvenu, à nouveau, de mes études et de Jean Rouch et sa « caméra à filmer dans les coins », je me suis souvenu de ce que le cinéma est un leurre, ou une image, juste une image comme disait Godard. Ivens quant à lui devenait de plus en plus présent, son « style » comme disait ce professeur, son « naturalisme » comme me l’indiqua un étudiant en cinéma de Lille, la poésie et l’engagement, et puis aussi l’eau, et puis aussi Stork et Chris Marker, dont j’adore le nom, Christian-François Bouche-Villeneuve, et l’image fixe et celle en mouvement de « La Jetée » dont me parleront les étudiants mexicains de dimanche prochain, avec ce sourire reconnaissant, celui qu’on peut apercevoir chez ceux qui écoutent une musique qu’ils aiment ou qui la jouent, ou qui regardent la toile peinte, ou les images fixes ou pas. Je me suis souvenu aussi, à cette occasion, des photographies de Berenice Abbott, contemporaine d’Ivens et complice Eugene Atget et de Man Ray, ou de Jane Evelyn Atwood rencontrée dans le parc, je me suis dit que les documentaristes n’étaient pas tous de gauche, finalement, ni tous communistes, ni tous engagés : il y avait Leni Riefenstahl et ses « Dieux du Stade », mais Jesse Owens et ses quatre médailles d’or, les jeux de 36 comme les congés payés, Léon Blum et la « non-intervention » au cynisme écoeurant, Daladier et Chamberlain, Munich et la deuxième guerre… J’ai demandé à quelques uns d’entre eux si « le documentaire » était pour quelque chose dans la démarche entreprise pour venir ici voir ces films, et cette évidence était trop présente pour qu’il y ait matière à discussion. Non, le documentaire, semblaient-ils me dire, on s’en fiche pas mal du moment que le cinéma est là. Le cinéma, oui, mais le bon, sans doute aussi… C’est ce qu’il ne faut jamais perdre de vue, avec le cinéma, c’est qu’on n’aime que celui qui nous plaît, pas les autres. Et les autres sont légion, évidemment. Et poser la question du documentaire à des spectateurs venus en voir, c’est comme demander aux cinéphiles ce qu’ils aiment dans le cinéma : tout, tout simplement. Et tout, tout simplement, lorsque ce tout est bon. C’est tout, et ce sera tout. Ce qui fait que le « genre cinématographique » est sans doute simplement une étiquette sous laquelle se rangeront des films comme les « western » , « policiers », « téléphone blanc » et autres « mélodrames psychologiques » : il y a sans doute autant de «genres cinématographiques » qu’il y a de « critiques cinématographiques » pour en inventer. Le « genre cinématographique » sert sans doute, mais seulement à ceux qui en ont besoin, les exégètes peut-être, les critiques, sans doute, ceux qui pensent que la « culture » est quelque chose qui ressortirait d’un ministère, comme « la santé » ou « la justice ». Pour les spectateurs que j’ai rencontrés lors de cette rétrospective, cette question-là n’avait guère de sens, ils ne savaient ou ne voulaient pas y répondre. Je crains qu’ils n’aient eu raison.
J’ai manqué « Valparaiso » et la voix de Chris Marker.
Ivens était aux Etats-Unis durant la guerre. La deuxième s’entend. La première, il semble qu’il ait été en train de faire des études, mais je n’ai pas lu son autobiographie qui existe cependant. Les tourments du siècle. La traversée, près de cent ans, avec ses cheveux blancs, bras ouverts, et qui filme le vent, l’âme des hommes comme leurs corps, leur force de travail, « pas ceux qui signent les contrats », non, pas ceux-là, choisir son camp, voilà tout.
Le samedi suivant, il n’y avait pas vraiment foule, mais ils étaient encore là. « Oh làlà, mais où est-ce que ça peut bien être, à la fin ? » demandait une femme, devant la porte. Elle trouva. Elle assista à la projection de films qui avaient été déjà programmés, et en sortant, elle s’arrêta un moment : on parla. Elle parla beaucoup de ses amis, de ses connaissances, du porte manteau qu’un jour elle avait amené « chez les Ivens rue des Saints Pères », de son affection pour eux, et pour lui « très gentil », et aussi des films qu’elle aimait, et aussi de sa famille, de son fils « Ahhhh !!!! Ne m’en parlez pas, il est diplômé d’architecture, il a cinquante et un ans, mais il ne fait que des conneries, il me coûte un argent fou», d’une de ses amies parlant de « Pierrot le Fou » de Godard : « mais enfin comment veux-tu que je m’intéresse à la vie de cette conne ? » Anna Karina « qu’est-ce que je peux faire ? j’sais pas quoi faire … » mais aussi « monte dans ton Alfa, Roméo » avec des rires, des cris, des plaisanteries, et aussi « Marceline, ah oui je l’ai croisée au marché Buci », la panoplie et le panthéon, les gens qui passent, lentement, parlant bas, comme s’ils étaient en train d’ourdir quelque complot secret, et qui s’en vont, sous le soleil éclatant du mois de juin, la belle vie, la beauté des choses, le vent, l’eau, le fleuve…
Cependant et malgré tout, il n’y a pas à dire, l’habitude, l’habitus, ne se perd pas si simplement. Dimanche, j’avais pour projet de tenter d’intercepter l’homme à moustaches, chaussures de prof, mais il n’est pas venu. J’avais aussi le vague pressentiment qu’il fallait s’intéresser aux adeptes de la cinémathèque, mais ça non plus ne s’est pas fait. Je n’avais pas fait le compte exact pour « équilibrer l’échantillon, au moins sexe et âge » mais j’avais bon espoir, il y a l’habitude qui fait que j’observe et ne m’adresse jamais à n’importe qui, il y a la chance qui fait que les humains sont tels qu’ils sont, certains s’échappent sans un regard, parfois un sourire « pas le temps, j’ai un train… » ou quelque chose du style, de la façon, de la persuasion aussi qui fait que je m’arrête, je regarde et je parle. Parfois, très rarement, ça ne marche pas. Très souvent, ça arrive. Il y a là quelqu’un, ou comme l’année dernière sur la pelouse, quelqu’une : il ou elle vient, on ne sait pas, ce n’est pas de la magie, ce n’est pas du hasard, c’est quelque chose qui arrive, j’accepte.
Ce dimanche soir, il s’agissait du dernier entretien, je le savais : il se ferait, ou ne se ferait pas ; j’avais sur bande magnétique une quantité de paroles, cette vieille femme au chignon blanc qui m’avait souri, qui avait parlé avec son accent tchèque ou slovaque, sans dire grand-chose, « c’est beau, c’est très beau », qui était née aux Etats-Unis, « je n’aime pas le pays », que je n’ai pas vraiment réussi à aider « ah les films que j’aime je ne saurais pas dire », l’amie des Ivens, la brocanteuse, et les autres, les étudiants en lettres, en cinéma, en histoire, en maths, les retraités, les femmes, pas d’enfant, pas du tout sauf ceux qui se fourvoyaient, voulant aller à Lumière en passant par Bertin, il y avait pas mal de monde, et la dernière séance avait été comble. J’y avais reconnu les habitués, j’avais regardé dans mon « dictionnaire du cinéma » ce qu’il disait de Joris Ivens, je ne crois pas que ça vaille la peine de le rapporter ici tellement c’est vieillot (mais le livre est de 82), mais j’ai trouvé tout de même que Gérard Philipe avait tourné avec Ivens, un « Till l’Espiègle » qu’il me semble avoir vu, tout comme le « Comment Yu Kong déplaça des montagnes » mais je ne savais pas qu’il y avait une douzaine de titres à cette compilation. Et puis, durant cette période, j’avais tout de même manqué la voix de Chris Marker, mais il revint dans les paroles et surtout les sourires, les deux sourires de ces étudiants qui me demandèrent l’affiche de la rétrospective parce qu’ils en faisaient collection, je leur ai laissé mon téléphone mais ils n’ont pas rappelé, ils se parlaient d’ailleurs plus entre eux, l’entretien avec des couples est assez délicat à mener, toujours, mais ils s’étaient répondu, lui en touchant son coeur : « c’est émouvant », et elle : « c’est intéressant, c’est profond… c’est un cinéaste très créatif » et lui « oui, très sage… ». Des mots simples. Puis ils sont partis, je m’en allai aussi, lorsque je vis cet homme, assis sur son banc, qui regardait le petit livret présentant les projections, et oui, il y avait été, oui, « merveilleux, c’est un homme merveilleux ». Il s’expliqua, longuement, passant par les détours de sa vie, de celle de ses parents espagnols et républicains, de ses études de cinéma à l’Idhec, des études qu’il venait de reprendre parce qu’il fallait qu’il se calme, qu’il se pose, qu’il réfléchisse. Il me parla longuement, m’interrogeant sur ce que je faisais là, comme beaucoup de ceux à qui je m’étais adressé, puis passant à autre chose, il me dit : « … j’ai été merveilleusement surpris en voyant au générique Nicolas Philibert, qui était au générique de ce film-ci, qui est un homme que j’adore, qui a fait « La vie, Le Louvre », qui a fait « Etre et avoir »… » et comme je lui demandais, parlant d’Ivens :
Et il vous a montré le vent, là, aujourd’hui ?, il répondit ce qui, s’il ne reste que cela de cette manifestation, devrait suffire :
« Oui… Oui, le vent, le vent de l’espoir, voilà, c’est ce qu’il nous montre et combien on en a besoin aujourd’hui, le vent de l’espoir qui souffle encore quand on voit ses films et où qu’il soit, je lui dis merci, et qu’il se repose bien, mais je sais aussi que la chaise n’est pas restée vide… ».
Paris le 10 juillet 2003




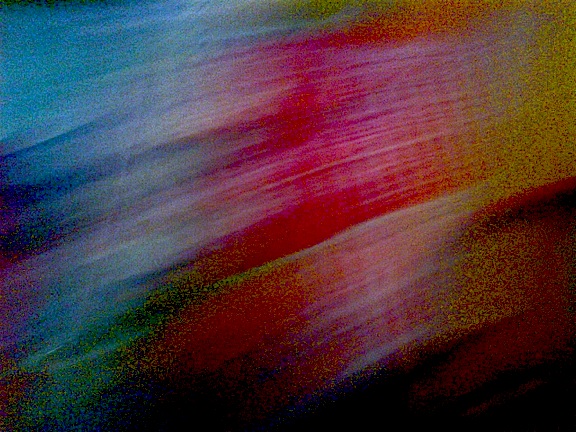










J’aime bien cette « étude » qui sait mêler le personnel à l’observation, l’individuel au collectif, le cinéma à la réalité, le documentaire à la fiction, le réel au rêvé, le hasard à la nécessité (oui, facile) et la galerie des personnages connus confrontés aux inconnus, l’évocation des films vus ou pas – Joris Ivens, que je connais beaucoup moins que le grand Chris Marker – les images qui laissent des traces indélébiles quand elles correspondent à quelque chose de profond (c’est pour cela qu’elles s’incrustent).
Le cinéma est également un chantier : d’ailleurs on y utilise parfois des grues (question de moyens).