Carnet de voyage(s) #67
Ici les rues recommencent à bruire, ça recommence à tempêter au volant, à crier, quelques uns encore restent au loin, j’apprends le nom de Tarifa,
ce qui est au fond, là, c’est le Maroc et l’Afrique donc, j’apprends le ciel bleu de l’Espagne
et puis oui, plusieurs semaines écoulées, le gouvernement avec à sa tête la même chose a changé, des photos, des contraintes, chercher recommencer, je me souviens il était peut-être deux heures et nous avions patienté à l’aéroport (plus de consigne nulle part où laisser les bagages, nous avions prévu un petit passage en ville, Naples, au loin Capri j’en sais rien, le Vésuve nous l’avions croisé en arrivant, j’ai toujours à l’esprit – un peu- le « Stromboli » (Roberto Rossellini, 1950) qui m’emmène vers « Voyage en Italie » (le même en 54) et entre temps voilà tout) l’Italie, voilà que nous la quittions
dans cet avion orangé (une horreur, mais et le prix ? on quête à présent dans les avions, on entend la voix de celle dont Alain Souchon avait fait un verbe, « ah le mal qu’on peut nous faire » disait-il), alors bien sûr on embarque (ces évidences, celles qui, toujours, nous traquent, nous imposent le silence, bien sûr on embarque, bien sûr)
le ciel, les trente trois degrés, le monde et les astres, l’homme, là
on passe, son crâne rasé et lui, probablement, tatoué, tu sais, on ne fait que passer, lui reste, avec son téléphone qu’il fixe
que veux-tu qu’on y lise, on avance, tout à l’heure on nous demandera en plusieurs langues d’éteindre nos appareils portables (pace-makers ? sonotones ?), l’avion avancera
et lui sera là, ailleurs, qui peut savoir s’il fera le sémaphore ? s’il conduit l’autobus ? s’il contrôle quelque chose, des bagages, des pressions de pneus, des arrivées de kérosène ? qui peut le savoir, tarmac à pied
sans vraiment de point, ma valise à la main, mon appareil dans l’autre, la première de cette série n’était pas réellement commandée, la dernière non plus, c’est sans lui mais avec eux qu’on entreprend le voyage
ciels et nuages, rejoindre sa place et boucler sa ceinture, s’ils pouvaient, eux, la boucler par exemple, non, deux cents personnes ne se taisent jamais, sauf en cas de malheur (les aéroports ont tous, pour moi, le goût de celui de Nice Côte d’Azur, partout, où que j’aille, j’ai sept ans, partout où que j’atterrisse c’est à Nice, en France, je me souviens de Médecin et de l’Uruguay, je me souviens de la moue ignoble et dédaigneuse de son successeur actuel et la ville alors m’apparaît probablement un peu différente, mais alors, n’était-ce pas une merveille ?), installé à son siège, là, les ailes de l’avion recourbées
voilà, on quitte l’Italie, bouclez la ceinture, éteints les appareils, le « personnel de bord » (quelles terribles injonctions, ces mouvements du masque à oxygène censé tomber devant soi, ces gilets de sauvetage criards pour qu’on nous reconnaisse dans les flots tumultueux qui ont vu s’abîmer tant et tant d’aéronefs, celui de Malaysia Airlines disparu, celui abattu par les miliciens russes, les hôtesses de l’air – ces métiers improbables- ces stewards – manches courtes gilets noirs sourires surfaits « bienvenue à bord » et ces ventes de parfums, cigarettes, whisky, ptites pépées– Georges Ulmer ou Eddy Constantine ? il est certain que la bêtise emprunte parfois la voie royale de la chanson), partir, tenir son carnet de voyage(s) tandis qu’aux ciels passent les nuages, partir, partir











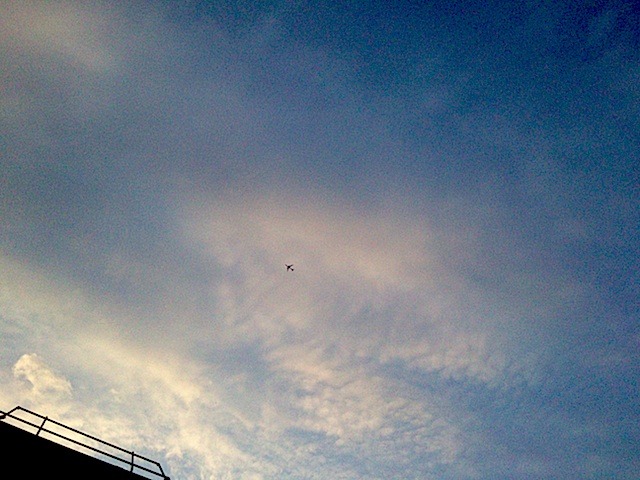

et malgré leurs efforts ils ne détruiront pas totalement la beauté
La dernière fois que j’ai pris l’avion, c’était pour Berlin. Il y a quelques jours, j’ai vu que le maire avait démissionné à cause du scandale financier causé par sa gestion du nouvel aéroport.
Difficile de piloter !
Belles photos (mais le type au crâne rasé, un peu trop de lui, à mon goût).