Trois
Il faut un peu de musique pour écrire, peut-être. C’est pourtant sans penser à ce travail, celui d’ici, que la photographie s’impose. Impossible de dire pourquoi, et quand on veut fixer quelque chose qui passe, comme le flux des images dans le noir de la salle, la lumière revient, le monde se lève, les voix chuchotent, celles des snobs informent l’assistance de l’émotion subie, la comparent, ici à celle ressentie en voyant Lucki (Luciano), là Enrico (Mattei)…
L’histoire qui est contée ici ne comporte guère de plan historique, comme les deux exemples plus haut. Il s’agit d’un homme,
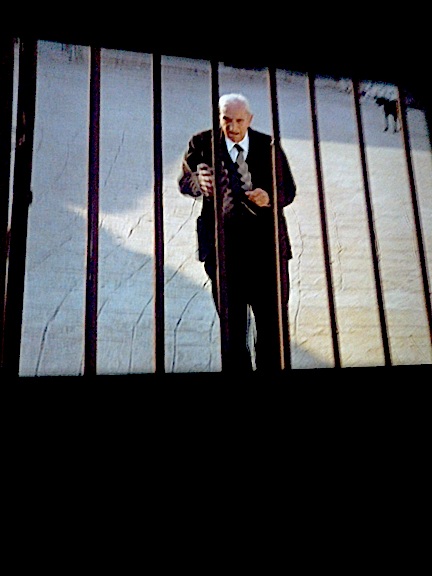 Charles Vanel incarne le père des « 3 frères ».
Charles Vanel incarne le père des « 3 frères ».
un vieil homme, qui a eu trois fils semble-t-il de la même femme, laquelle vient de s’éteindre. Un homme qui perd sa femme, trois autres qui perdent leur mère, une petite fille qui perd sa grand-mère. C’est vieux comme le monde. Et comme la musique.
Ces trois frères ont eu des destinées diverses. L’un d’eux, incarné par Philippe Noiret (doublé, une catastrophe) est juge; on se remémore « Cadavres exquis », la théorie de la tension et les années soixante dix en Italie; le deuxième (Michele Placido) vient de se séparer de sa femme, semble-t-il assez prolétaire, ouvrier peut-être, syndicaliste ou syndiqué très probablement, vient ici avec sa fille qui est amie avec son grand père; le troisième (Vittorio Mezzogiorno) est surveillant d’une maison de correction. Chacun à son tour fait une sorte de rêve.
 Les trois frères occupent la même chambre dans la maison du sud.
Les trois frères occupent la même chambre dans la maison du sud.
C’est le sentiment qui les unit, la perte de leur mère, qui rend le film attachant : une femme qu’on pleure, une mère, une grand-mère. La petite fille se roule dans les grains de blé, dans le grenier, juste au dessus de la chambre de sa « nona ».
Des rêves et des souvenirs : l’alliance qui unit le vieux couple (Charles Vanel, mais quel acteur…), il la glissera à son annulaire.
Cette alliance que sa femme avait perdue sur une plage (on pense à Fellini), au loin dans l’image, son mari -interprété par Vittorio Mezzogiorno, c’est ça, le cinéma, le fils est le père d’un plan à l’autre, quarante années séparent deux plans- ils recherchent ensemble l’alliance, la retrouvent dans le sable, la grand-mère, jeune fille, qui enfoncent ses pieds et ses jambes dans le sable, comme la petite fille tout à l’heure dans les grains de blé… On aime qu’ainsi les choses et les actes se répondent de génération en génération.
Le film se clôt. (« Trois frères » Francesco Rosi, 1981).
On sort, j’avais pris la voiture, j’étais seul, on se trouve derrière la gare de Lyon
on passe, je regarde le temps passer, je marche dans les rues je cherche souvent des salons de coiffure pour le Notulographe, c’est comme un but, tout comme je cherche des lions ou d’autres animaux (des paons, des béliers, des boeufs…), c’est que les vacances se sont enfuies, je travaille et je nettoie, il y a la pluie et le vent, les cafés, les gens et tous ceux qui s’en sont allés
ce n’est rien, j’attends, pour mon frère son poids en vin, les rires à la terrasse du Wepler, ce n’est rien.
J’attends.
J’ai croisé aussi ce sept de travers
j’aime savoir qu’il fabriquait aussi pianos et harpes. C’est que, quelquefois, il faut un peu de musique pour écrire.


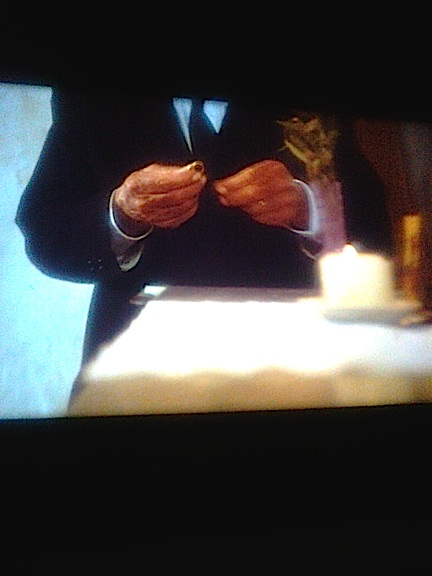




un peu de musique… et pour nous des mélodies gracieuses et attachantes
tant mieux si vous les entendez…