Carnet de voyage(s) #27
On ne peut pas se tromper : la route part de la station service, on l’emprunte
en lacets, personne, en bas il faisait beau, en haut les nuages bruissent
on a froid on tremble un peu, on croise des chèvres et des cailloux, rien, quelques végétaux, on monte encore, les virages on s’accroche, encore et en haut on découvre le sémaphore, dans sa brume, un panneau indique l’interdiction d’aller plus loin, faire demi-tour sur une route de montagne, l’un de nous descend et guide, encore un peu encore… on gare l’auto sur le bord du chemin, d’autres passeront outre et iront faire leur demi-tour à l’entrée , un peu plus haut, on montera
le paysage, des cartes postales, on découvrira la mer qui, tout autour baigne le cap, au loin on découvrira la plage de sable blanc qu’on fréquente, loin, si on la voit aujourd’hui c’est que de là-bas aussi, nous nous verrions
et chaque jour, ensuite, on regardera « tiens pas de nuage… » on regardera, on prendra un cliché parce que c’est joli, on les postera peut-être,
on les regardera au retour, au loin les îles
Zembra et Zembretta, des noms aux consonances italiennes, qui rappellent que l’Italie, comme la France, ici, avait quelque chose à prendre, ou à donner c’est moins sûr, un homme qui marche sur la plage, les éoliennes qui veillent
El Haouaria ville blanche, une merveille, une plage encombrée de débris, au loin les îles, laissez derrière soi la baie de Tunis, retraverser, arriver à la nuit, garer la voiture
et parcourir la petite médina, acheter des cigarettes, voir un tailleur au travail, il est dix heures du soir, les humains ici ont rompu leur jeûne, mangé
se mettent au travail, ici un salon de coiffure
à l’épicerie où on achète des cigarettes
des ombres qui passent
les magasins ouverts jusqu’à une heure du matin
les rues pleines de monde, les hommes aux terrasses des cafés qui jouent aux cartes sur des tabourets, qui boivent du café, la nuit qui sourd sur les avenues et les boulevards, on a mangé du poisson, dehors les odeurs de la nuit
la musique de la boîte de nuit sur le bord de la plage, les jeunes gens qui se baignent à minuit, et le temps de regarder un peu l’ombre, démettre la table, ranger et faire la vaisselle, regarder les restes, et comparer avec ici, je ne sais plus, je ne regrette rien mais les proportions, prises alors qu’à table il y avait du monde, à présent ont changé, et je n’oublie pas qu’à la mort de mon père, nous n’allions plus jamais « à table » mais déjeunions et dînions sur les fauteuils en faux cuir du salon, la petite table (celle où on pose les livres qui vont dessus) en bois foncé, passée au brou de noix, cirée, aux pieds un peu tores, bombés, arqués, probablement cadeau de mariage, tout comme les verres qui étaient retournés dans le confiturier du coin de la salle à manger, cette salle-là où on posait un lit lorsque le grand père venait passer ici deux mois, assis devant la fenêtre, regardant la rue son calot sur la tête, son petit livre de contes en hébreu, son canif à tailler les crayons, sa tabatière en argent
sa main sur ma tête, « c’est pour te bénir » me disait ma tante, mardi dernier, ainsi que cette femme, « j’ai quatre vingt huit ans, ya amri » me dit-elle, je lui portai un sac de plastique, à l’aéroport de l’Aouina, samedi dernier (pas hier) à cette heure-ci, elle s’envolait pour Alger, toute de blanc vêtue, les yeux cernés, elle s’assit et me dit d’approcher, me mit la main sur la tête, tout comme mon grand père, « Dieu te bénisse » me dit-elle, « je me souviendrai toujours de ce que tu as fait pour moi », mais presque rien, juste porter un sac une centaine de mètres, une vieille dame, ses cheveux dissimulés sous cette si belle étoffe blanche, les cernes de ses yeux, son sourire, quatre vingt huit, « ma mère en aurait quatre vingt six, vous savez… » son sourire « aichek », j’ai rejoint les miens dans une autre salle, nous avons été acheter du parfum hors douane, sur le tarmac les avions Egypt’air, Qatar, la Gazelle, j’ai dévié, oui, j’en ai fini aujourd’hui, mais il me reste encore des images, des fonds d’écran, mais ici j’ai celui-ci












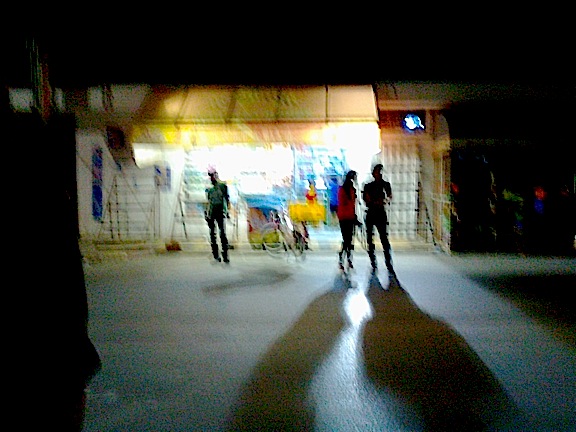





la beauté… et la main sur la tête (mon père aussi)
Superbe — et me rappelle la frustration d’un cliché évident, rendu impossible parce que conduisant sur une route des Cévennes, il y a (trop d’/des) années: lumière de soleil levant sur un arbre mort, face à un mur de brouillard…
Le temps de trouver un espace où garer sans tuer un éventuel usager de la route, impensable — et ne restent que les mots pour dire la vue…