Luchino et Jeffrey
La dernière fois c’était au cinéma Nouveau Latina. On y donnait « Sandra » (Luchino Visconti 1965) , c’était un samedi après midi, vers seize heures, je crois bien, la salle était assez pleine, et Claudia Cardinale et Jean Sorel
Sandra (Claudia Cardinale) et Gianni (Jean Sorel) dans le rôle des deux enfants devenus grands
interprétaient une sombre histoire plus ou moins oedipienne, ou alors incestueuse, ou peut-être les deux à la fois, j’ai pris quelques photos, et un vieillard (dans les soixante quinze piges aux pelotes, à peu près, de l’autre côté de l’allée, à la fin du film) m’interpelle : « Vous pourriez arrêter de regarder votre portable pendant le film quand même », je ne sais plus, s’il y avait de la vulgarité dans les mots, mais dans le ton, certes. « J’ai juste pris des photos » dis-je comme un idiot (de idios, veut dire particulier)
 De dos Claudia Cardinale, face à son beau-père
De dos Claudia Cardinale, face à son beau-père
alors qu’à ce genre d’invective plus ou moins outrée, on gâcherait son crachat mais passons, l’espèce humaine, particulièrement sa composante mâle est fréquemment infecte, et je ne suis pas spécialement social traître disant cela mais simplement objectif. J’aime pourtant qu’on « donne » un film en après midi; j’aime aussi particulièrement « prendre » des photos (j’officie avec mon téléphone portable uniquement, c’est un gimmick, un style ou une manière).
 Marie Belle dans le rôle de la mère de ces deux enfants tentés par l’inceste.
Marie Belle dans le rôle de la mère de ces deux enfants tentés par l’inceste.
Avec Claudia Cardinale, il n’y a pas seulement le noir et blanc qui est apparu, mais aussi ces réminiscences du Guépard (Luchino Visconti, 1963) réalisé quelques années auparavant (j’avais dix ans, t’as qu’à voir, je jouais avec des voitures en modèle réduit, dans l’entrée, ma mère pleurait la neige et la froidure de la Picardie). Claudia Cardinal, tout comme Anna Magnani ou Françoise Fabian, ces brunes du cinéma, ces étoiles filantes (elles filent, nous filons tous vers ailleurs) qui me rappelaient ma mère parce qu’il faut bien que les fils aient, pour leur mère, quelque chose de spécial, de particulier (idios) et la voilà avec son (peut-être demi-) frère (Jean Sorel : on pense à Jean Cocteau et à Jean Marais, cette affaire est un peu trouble, il faudrait y retourner voir exactement : chez Visconti, comme on sait, tout est toujours en reflet, s’inverse,
se double et se tutoie : à qui a-t-on affaire ? jamais on ne sait, rien n’est clair univoque ou simple…) plongée dans des turpitudes toute viscontiennes. Gianni se suicide aux médicaments, la mère plus ou moins folle (interprétée par Marie Belle,)assiste au dévoilement d’une plaque en l’honneur de son ex-mari, le film se termine dans un jardin.
Cette invective du vieux type aigri en fit apparaître une autre, à la cinémathèque,
 Un reste de la Femis au palais de Tokyo
Un reste de la Femis au palais de Tokyo
encore un sale type que ma présence indisposait peut-être, j’ai glissé sur les marches me suis rattrapé sans encombre et j’ai entendu venant de sa part un « bien fait », mais il s’est détourné lorsque j’ai voulu lui demander une explication. C’est ainsi, le monde des hommes, on ne le connaît pas, peut-être, mais il est là, présent : entre eux, ces bipèdes apprécient de s’insulter, de se rouer, la violence est leur propos, leur propre propos, on veut s’expliquer « entre hommes »et ces appareils, avantageusement dissimulés sous des complets trois pièces, oints de parfum capiteux dans le meilleur des cas (c’est pour dire) aiment à plaire en faisant jouer sous ces apparats de luxe leurs pauvres anatomies musculeuses. En effet, non, parfois, je n’aime pas mes semblables. Souvent. Et pourtant, le cinéma, celui qui se déroule sur l’écran, qui a disparu déjà, qui n’est plus que dans nos imaginations, celui-là apporte parfois, et grâce à ses acteurs (on ne voit qu’eux…) quelque chose d’une humanité, mâle peut-être, mais au moins digne et fébrile, sensible et vraie, simple et claire, quelque chose de la réalité qu’on peut croiser, parfois, dans une ride qui d’un sourire se creuse, d’un éclat dans les yeux, ou les gestes, le mouvement des cheveux ou celui des lèvres, des joues ou des bras soudain resserrant le corps, des choses de la posture, de l’amour probablement, mais qu’on ne découvre que rarement dans les mots (ou alors dans cette intimité de la conversation dont je dois dire que je ne la partage que rarement avec ceux de mon genre : j’ai peu d’amis).
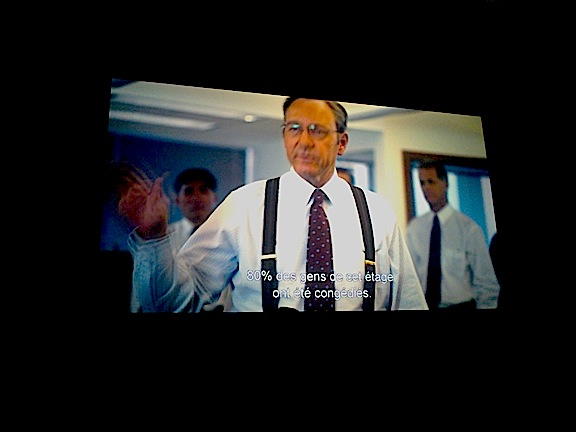 (Kevin Spacey) après la charrette : « 80%des gens de cet étage on été congédiés » (pas foutus à la porte, virés ou lourdés, non)
(Kevin Spacey) après la charrette : « 80%des gens de cet étage on été congédiés » (pas foutus à la porte, virés ou lourdés, non)
Dans la salle où l’année dernière nous étions sortis au bout de quatre vingt dix minutes éprouvantes de la vision de « The Tree of life », Studio 28 (car ouvert en cette année-là du siècle dernier, le muet vivait encore mais le parlant commençait à poindre), on donnait samedi vers dix neuf heures, un film américain « Margin Call » qui met en scène pratiquement toute la sphère de la finance, un lieu du monde qui nous est virtuel et qui reste inabordable (le bas de l’échelle, le petit vendeur de vingt trois ans – interprété par Penn Badgley- a gagné l’année dernière un demi-million – deux cent mille euros; le milieu de gamme -interprété par Paul Bettany- dix fois plus; le haut de gamme -interprété par Kevin Spacey-, sans doute aussi dix fois plus; et enfin en haut de l’échelle, interprété par Jérémy Irons, sans doute encore cent fois plus, mais on ne sait…). Il s’agit d’un univers où le chiffre, le nombre (notamment de dollars) tient lieu de morale.
Je passe à la ligne.
S’agirait-il de notre monde ? J’ai pris quelques clichés. Dans la file d’attente (on n’entre en salle que lorsque le public de la séance précédente en a fini), il y avait un type, chemise un peu flottante bleue sous une veste qu’il ôtera tout à l’heure, accompagné d’une femme en pantalon blanc, assez chic genre, entre cinquante et soixante, qui regardait sur son petit téléphone la bâche verte (aux couleurs d’une banque) qu’étendaient les servants des courts de tennis, la pluie faisait cesser la finale (et donc il s’agissait de dimanche).
Le type a ôté sa veste, il avait chaud, il a parlé avec celle qui l’accompagnait et rangé son appareil dans sa poche. Le public de la séance précédente sorti, on s’est installés au sixième rang. Un premier film réalisé par un inconnu (il aurait dans les trente cinq ans) avec deux acteurs formidables (le grand chef, interprété par J. Irons, n’entre en scène que vers la moitié du film), et d’autres, un univers d’hommes, âpres au gain, on dit « greed » en anglais. Tout aussi bien, le film aurait pu s’intituler ainsi.

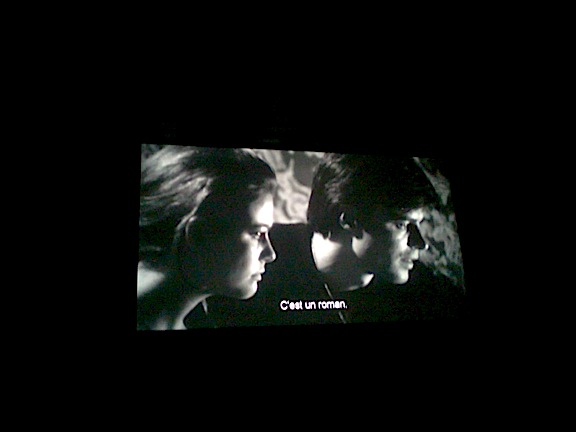

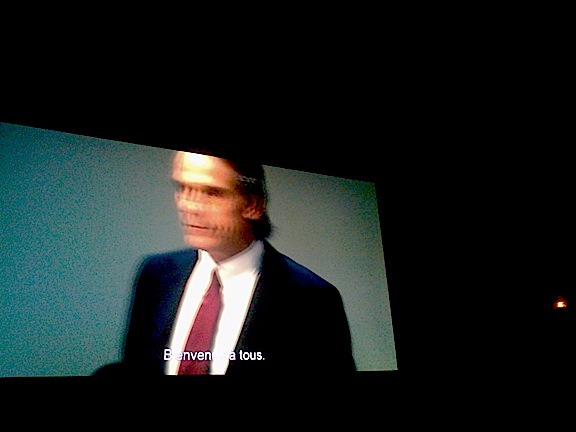

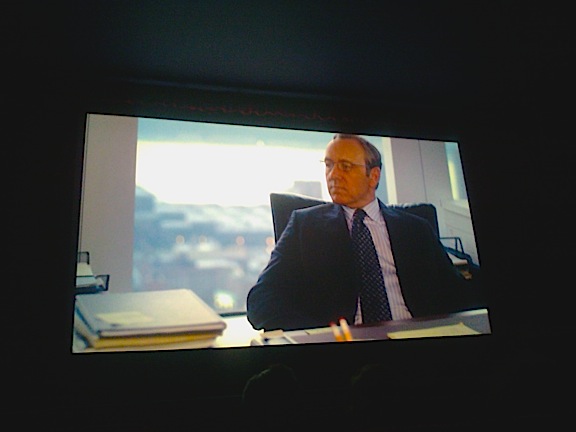

Il faut que j’aille le voir, Margin Call (avant Metropolis et ses limousines).
Dire que tu as failli tomber ! La chute est l’un des ressorts des films comiques (puisque tu parles de noir et blanc), certains en sont donc restés à cette vision du « rire » (Bergson allait-il au cinéma ?).
Je te souhaite de plus nombreux amis.
C’est gentil, ce souhait (j’en ai peu, mais des bons…)(et d’ailleurs, à la quantité j’ai toujours préféré la qualité). Merci d’être passé (Metropolis de Fritz Lang ? je ne me souviens guère de limousines…)
Le lapsus était incontournable : je voulais évidemment parler du film de Cronenberg, « Cosmopolis » !
[…] à nouveau dans ce cinéma où on a vu « Sandra » (Luchino Visconti, 1965, Vaghe stelle d’ell Orsa), pour une merveille sur un écran de trois […]