La danse sur grand écran
Lorsque je vais au cinéma et que je prends des photos de ce qui est sur l’écran, je pense à mon prof d’image fixe/bande dessinée. Il s’appelait Francis Lacassin et avait un sourire sympathique, il nous parlait de la photo et de sa manière de capturer le temps. Dans ce nous, il y avait Bernard F. qui est à présent réalisateur à la télé, il y avait Sylvie R. que j’ai perdue de vue, qui avait un coiffeur qui venait à domicile, H. , chez qui je vais me faire couper les cheveux, encore aujourd’hui, rue de C. C’était à la fin des années soixante dix, nos vingt ans, et chaque fois que je regarde un film, je tente d’en prendre une photo, depuis que j’ai sur moi cet appareil formidable, mon téléphone portable.
Bien sûr les photos ne sont pas « bonnes » et bien sûr, arrivé chez moi un peu plus tard, je les transfére sur une toute petite carte de deux gigas quand même,
que j’insère ensuite dans un lecteur de carte (mon ordinateur ne reconnaît pas mon téléphone portable) (de nos jours, les appareils se saluent ou s’ignorent, suivant qu’ils sont de la même marque ou du même bord : c’est un monde merveilleux et enchanté que celui des appareils).
Sur mon écran se dessine alors une sorte de petit gâteau (un figolu©) en dessous duquel est inscrit « no name »
à l’intérieur duquel (ce ne sont pas des figues) des « dossiers » (ces trucs sur lesquels on s’appuie, quand on est assis) sont nommés (par moi, tout à l’heure, avec mon téléphone portable) du nom des jours où je les ai créés.
Voilà.
Samedi soir (on sort parfois, le samedi soir, avec mon amie), nous sommes allés voir « les Rêves dansants », un documentaire allemand tourné tout au long de l’année 2008 par Anne Linsel et Rainer Hoffmann (j’aime savoir que les films ont été « tournés » parce que j’aime savoir que le cinéma, toujours, tourne les choses et les gens, les acteurs et les décors, les tourne à leur avantage – et parfois aussi, au sien).
Il s’agit de raconter comment des jeunes gens commencent à connaître ce que disent leurs corps, à travers la danse, la chorégraphie, les mouvements enseignés par deux femmes magnifiques, Jo (Ann Endicott, à droite sur l’image suivante) et Benedict (Billiet),
sous titre : … d’autres rateront leur entrée et seront complètement perdus…
anciennes danseuses de la troupe de Pina Bausch, duo de choc, formidable équipe de pédagogues, toutes deux tendues vers ces jeunes gens,
leur expliquant simplement comment être soi. Comment être vrai. Comment le montrer avec son corps. Il s’agit de vitesse, de lenteur, de temps pris et gagné sur le reste du monde.
Avec mon téléphone portable, j’ai arrêté quelques instants de ce film. Il y avait du monde dans la salle.
A la fin, il y a eu quelques applaudissements (dire bravo à un écran, je n’ai jamais pu). Nous sommes sortis. Dehors, il faisait froid, un peu de pluie, nous étions dans ce cinéma sur les bords du canal qui appartient à ce krypto-ministre de la culture, ancien maoïste tout comme le prochain premier ministrable, tous ces gens et ce monde englués dans ce qu’on a coutume de nommer « les affaires ». La jeune fille, le premier rôle probablement (elle est assez présente à l’écran, blonde évanescente, comme le Romanichel, sympathique premier rôle masculin, brun et tendre) la jeune fille a les yeux embués, elle parle de son père, mort il y a quelques années, elle voudrait ne pas pleurer, et pense qu’il serait fier d’elle, s’il pouvait la voir. Et qui m’empêche de croire qu’il le peut (lui, ou Francis Lacassin, ou mon propre père) ?
Voilà, le cinéma, comme la littérature, donne à voir aux morts ce que nous sommes devenus (ou l’inverse, je ne sais plus). C’est pour ça qu’on l’aime. Alors, lorsque Pina Bausch voit ce film,
elle avec ses lunettes, ses chaussures plates, sa queue de cheval et ce si gentil sourire, ces rides fines sur son front droit, ses cigarettes et son ton doux, calme, posé, intelligent, sensible, lorsqu’elle le voit, qu’elle se voit offrir à chacun une rose, chacun lui donnant en échange un baiser, elle sait que c’est de la jeunesse dont lui vient cet amour, et elle demeure tranquille et heureuse, comme nous, ce soir-là, grâce à elle, grâce à eux, sur les bords du canal.


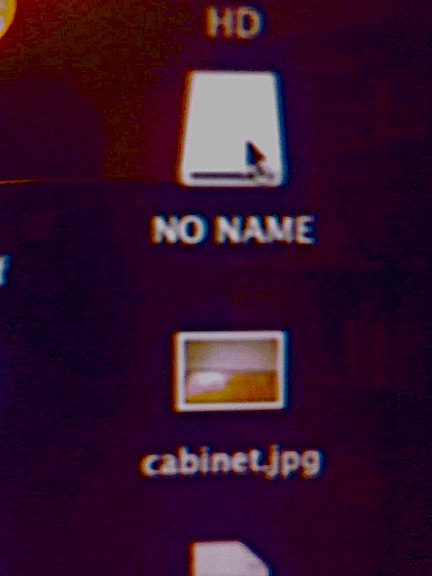
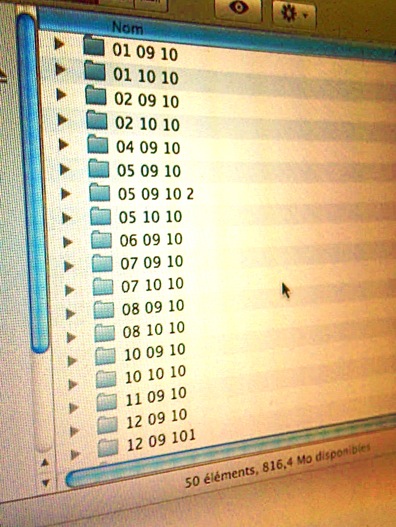






pas attendu longtemps (bravo pour les photos, n’y ai jamais pensé au cinéma, par contre moi non plus je ne peux pas applaudir un écran, même celui où ce billet apparaît
Cela fait plaisir de lire ton texte sur ce film (pas vu). Francis Lacassin, oui, je pense souvent à lui (et à Christian Bourgois) quand je vois un 10 x 18.
Au cinéma, je ne prends jamais de photo, ce serait sortir de l’écran dans lequel je suis entré par effraction. Mais il y a des voleurs d’images comme des voleurs de feu ou d’eau.
Karmitz, Borloo : le petit livre-gouge, comme instrument pour « percer » ?